|
Restitution du tarot de Wirth
Il y a cinq ans, j'ai rencontré une collectionneuse
avec qui nous avons
correspondu sur divers sujets autours des tarots. Lorsque j'appris que
ma
nouvelle
amie disposait d'un exemplaire original du premier tarot
d'Oswald Wirth de 1889, je fus tout de suite enthousiasmé à l'idée d'en
réaliser une
restitution.
|
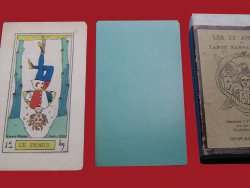 L'édition originale de 1889.
|
|
Études préliminaires
Mon amie pensait également qu'il serait intéressant de
pouvoir
redonner vie à un tel jeu et elle me fournit des images de son
exemplaire en très haute définition. Je fis des recherches de différents supports
(teintes de papiers, épaisseurs de cartons) ainsi que des essais de
couleurs au pinceau. J'envoyai le résultat de mes recherches à mon amie
qui put m'orienter dans cette démarche, confirmant la qualité de mes
essais, et critiquant les points qui pouvaient être améliorés. Cela
nous mena au final à une carte prototype assez satisfaisante pour
envisager d'aller plus loin.
|
|
Vers une meilleure
source
Pour une qualité de restitution optimale, il me
fallait
disposer d'images permettant de séparer le trait noir des autres
couleurs afin de contrôler les teintes, méthode déjà éprouvée pour
mes précédentes restitutions : Dans le
cas du tarot de Nicolas
Conver, j'avais
entièrement dessiné les images, dans celui de Nicolas
Rolichon,
le
document dont j'étais parti était déjà au trait. Mais avec les images
du tarot d'Oswald Wirth provenant de mon amie, il me fallait séparer
moi-même les
couleurs du trait. J'avais également envisagé de partir d'images au
trait (et sans colorisation), telles qu'on peut en trouver dans la
première
édition du Tarot
des Bohémiens de Papus ou dans ses traductions anglaises. Mais
à cause des rééditions
successives de
ces livres, le trait est trop grossier.
Je me suis alors procuré la première édition de 1889 de l'ouvrage de
Papus, les dessins présentaient malheureusement de
légères différences avec l'original de mon amie (traits manquants et
légères bavures). Je me résolus donc à utiliser les arcanes originaux
en haute qualité et à en retirer les
couleurs moi-même.
|
 À gauche, l'image tirée de
l'ouvrage de Papus, certains traits manquent et d'autres bavent. À
droite celle obtenue à
partir des cartes originales.

Image en haute
qualité, à laquelle seront ultérieurement retirées les
couleurs (voir ci-dessus à droite)
|
|
Reconstituer le trait
Si j'avais cherché d'autres sources d'images exemptes de
couleurs, c'est que je savais que l'opération de séparation du
trait puis de nettoyage serait particulièrement longue. En
effet, pour conserver la nature même du trait original, réalisé par la
main de Oswald Wirth à la plume, il me fallait pour cela passer
par
quatre opérations :
1) Redresser
les images et les recadrer afin qu'elles tiennent
toutes dans un rectangle d'absolues mêmes dimensions, afin de garantir une
parfaite
homogénéité de l'ensemble des vingt-deux arcanes ;
Ce travail de longue haleine se trouva réparti durant quatre
années, qui me permirent d'obtenir le dessin final des
vingt-deux arcanes. 2) Retirer les couleurs (jusqu'à quinze sur certaines cartes) afin de ne révéler que les traits noirs ; 3) Supprimer les traces de couleurs restantes en grossisant l'image suffisamment pour un résultat absolument irréprochable ; 4) Ajouter quelques traits noirs là où il semblait que des effacements, indépendants de la volonté de l'auteur, s'étaient produits. |
 Phases 2 à 4 : afin de
supprimer les tâches et d'ajouter des manques dus aux défauts
d'impression, des centaines de
retouches unitaires ont été appliquées (ci-dessus mises en évidence en
rouge)
 Résultat final : un trait
propre,
dans lequel on retrouve les subtilités des pleins et déliés de la plume
d'Oswald Wirth.
|
|
La mise en couleurs
Bien que cette technique soit en train de
devenir obsolète à son époque, Oswald Wirth avait pris le parti de
mettre son tarot en couleur au pochoir. En effet, depuis le milieu
du xıxe
siècle, on imprimait déjà des jeux de cartes en chromolithographie. Il
n'est pas
impossible qu'Oswald Wirth ait fait le choix du pochoir
pour faire référence aux tarots populaires que l'on trouve dès
le xvııe
siècle. Il est aussi envisageable que ce soit pour conserver un
meilleur contrôle de la qualité des couleurs, et peut-être aussi
pour des raisons économiques : en mettant ses tarots en
couleurs
lui-même au fur et
à mesure des commandes. Pour respecter cette volonté,
j'ai réalisé les textures de pochoirs suivant les mêmes
techniques que
celles mises en œuvre pour mes précédentes réalisations artisanales. Quant à la
teinte originellement dorée appliquée sur certains éléments, elle a été
remplacée par une couleur qui évoque l'or : l'ocre jaune.
|
 Mise en couleur
avec effets
de pochoir. Le doré (ici dans la couronne) est remplacé par de
l'ocre-jaune.. Le fond ivoire est teinté dans la masse du papier
|
|
Le livret d'accompagnement
Le tarot étant prêt, il me
fallait enfin envisager la rédaction du livret d'accompagnement. Je me
replongeais dans mes ouvrages d'Oswald
Wirth pour en extraire l'essentiel. Le Tarot des imagiers du
Moyen-âge fut le principal livre consulté, mais
d'autres, tels Stanislas
de Guaita, souvenirs de son secrétaire, les deux
biographies de 1975 qui lui sont consacrées, ainsi que d'autres
ouvrages taromantiques (Éliphas Lévi), et historiques (Thierry
Depaulis)
m'ont permis d'extraire un récit de ce tarot occultiste. Par
ailleurs, afin de proposer aux étudiants en taromancie de se mettre
le pied à l'étrier en matière de kabbale,
j'ai également synthétisé
en huit pages l'essentiel de l'alphabet hébreu et de l'Arbre de
Vie.
|
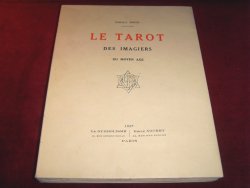
L'ouvrage de référence
par Oswald Wirth.
|
|
Édition
Durant tout ce processus de création, s'est
posé un certain nombre de questions concernant le format, le motif du
dos de cartes et le grammage. Il me semblait évident que pour l'édition
artisanale, le format devait être identique à l'original afin
de restituer un facsimilé le plus fidèle possible : cartes de
grandes
dimensions (80 mm × 140 mm), à dos en papier vert clair sans motif et à
coins arrondis. Ce format requerrant une plus grande surface de papier
et donc de travail de contrecollage, le prix final s'en est
sensiblement ressenti.
C'est pourquoi, j'ai aussi envisagé de réaliser une variante de format
standard (60 mm × 120 mm), à petites marges de
2 mm (permettant aux images d'être aussi fortes que sur la
grande
édition), à dos ivoire et motif bleu, et à coins
carrés. Ces deux éditions espèrent ainsi répondre à
l'attente des passionnés, collectionneurs, historiens et tarologues.
|
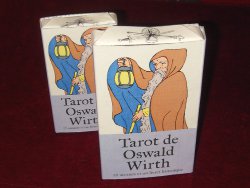 Deux
éditions artisanales sont disponibles : format standard et format grand (identique à
l'édition originale).
|