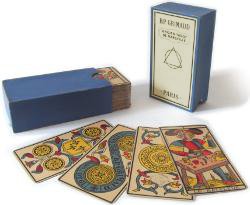|
Les origines du tarot
de Paul Marteau
|
|
Les
postulants
Si nous recherchons dans la multitude de
tarots de type II
(ceux dont le graphisme s'approche suffisamment de celui de
Paul Marteau), nous en trouvons plus d'une dizaine.
Mais par le nom que Paul Marteau donne à son tarot, il y a
une référence directe à un ancien jeu provenant de Marseille.
Il ne nous
reste donc plus que,
(par ordre chronologique) ceux de Nicolas Conver (1760),
François Bourlion (1760), Joseph Feautrier (1762), François Tourcaty
(1745), Suzanne Bernardin (1839) et
éventuellement un tarot antérieur à tous ceux-là et dont nous ne
connaissons pas le lieu de
fabrication, celui
de François Chosson (1672). Paul Marteau, étant lui-même
collectionneur de jeux de cartes, il faisait très
certainement référence à un jeu qu'il possédait, ce
qui permettrait de supprimer de la liste le tarot de Chosson (source :
Catalogue de la donation Paul Marteau, Bibliothèque nationale, 1966).
Cela nous laisse encore trop de possibilité pour retrouver
l'origine de notre ancien tarot de Marseille.
Heureusement, quelques informations permettent d'associer le
tarot de Paul Marteau à l'un de ceux
pré-cités et donc de retrouver la plus ancienne référence de l'Ancien
tarot de
Marseille de Grimaud.
|
 
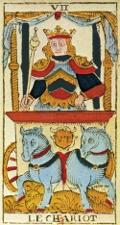 Suzanne
Bernardin Nicolas Conver


François Tourcaty François
Chosson
|
|
Le plus ancien modèle
En 1880, le tarot de Nicolas
Conver se voit encore imprimé au pochoir, mais avec une palette
réduites à cinq couleurs (rouge, jaune, bleu, rose et noir, le vert
étant obtenu par
superposition
du bleu et du jaune) au lieu de six pour les éditions précédents. Cette
édition jouera un rôle essentiel dans les choix qui mèneront Paul
Marteau à réaliser son tarot, puisque'il en reprendra très précisément
les teintes
en les appliquant
quasiment de la même manière. Par ailleurs, c'est à partir d'une autre
édition du tarot de Nicolas Conver (celle réalisée par la maison Camoin
en 1960) que Paul Marteau illustrera son
ouvrage Le
tarot de Marseille. Nous
pouvons donc
affirmer que le tarot Grimaud de Paul Marteau descend
bien de celui de Nicolas Conver, en tout cas, au moins de l'édition de
1880. Par ailleurs, Paul Marteau ayant possédé dans sa collection
un exemplaire du tarot de Nicolas Conver datant d'environ
1800, il semble qu'il ait aussi
fait référence aux toutes premières éditions de ce tarot. À ce stade,
le
mystère de l'origine du tarot de Grimaud semble avoir
été résolu. Mais celui
de Lequart se
situant chronologiquement entre le Conver
et le Marteau, ne joue t-il pas un rôle dans cette histoire ?
|
  
Nicolas Conver
Paul Marteau
1880 1930 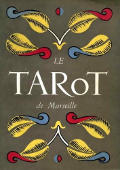 Cette
édition du livre de Paul
Marteau
(1970) est illustré des images du tarot de Nicolas Conver de 1960 |
|
Lequart entre dans la danse
Édité plusieurs fois par la maison Lequart entre 1880
et 1890, ce jeu nommé
Tarot italien
reprend très précisément le dessin des anciens tarots cités
ci-dessus (1672 à 1839),
à trois
détails près : les images sont redessinées avec un trait légèrement
plus gras, les
six couleurs
au pochoir sont
entièrement revisitées, et à partir d'une certaine édition, la
Papesse et le Pape sont remplacés par Junon et
Jupiter, faisant ainsi de ce
jeu un tarot dit de
Besançon (Alors que les premières éditions Lequart
avaient bien le Pape et la Papesse, voir ci-contre). Le deux de deniers
est daté de 1748. Il ne s'agit pas
de la
date d'édition de ce jeu, mais de
celle de l'attestation d'un cartier parisien du xvıııe
siècle,
Arnoult, dont Lequart avait acquis
le fond
et utilisé le nom et la date, probablement pour donner un ton
d'ancienneté à son tarot tout récemment dessiné aux alentours de 1880.
Contrairement
aux tarots du xvııe et
xvıııe
siècles, le Chariot ne mentionne pas les initiales du
graveur : le blason a
totalement
disparu. Autre détail amusant : l'ange du Monde est barbu. Pour en
revenir à notre enquête, il n'est pas aisé de dire quel
jeu a servi de modèle pour
le tarot italien de Lequart, car même si l'on est tenté de proposer
celui de Nicolas Conver, aucun indice ne nous permet d'affirmer quoi
que ce soit avec certitude et il pourrait bien s'agir de
n'importe
lequel des tarots du xvııe et
xvıııe
siècles, évoqués en début de cet article.
(Note : pour une interprétation du tarot de Besançon, lire cet article) |
 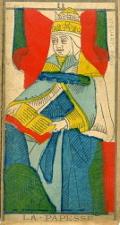
Bateleur
Papesse

La Papesse est remplacée par
Junon

Il n'y a pas de signature sur
le Chariot
|
|
Changement de propriétaire
En 1891, Grimaud acquiert la maison Lequart et
poursuit l'édition du
tarot italien en effectuant deux modifications majeures. Bien que la
palette de couleurs soit inchangée (mis à part le bleu ciel
qui devient gris), ces dernières sont appliquées
légèrement différemment et présentent même des effets de tramages
(comparez ci-contre dans les rouges avec les images du Lequart, deux
images plus haut) ainsi que de subtiles retouches de
finition,
comme un léger rehaussement de rouge sur les lèvres de Junon. La deuxième
modification est la
signature du cartier : elle apparaît à nouveau sur le Chariot et l'on y
voit
dans une sorte de blason, les lettres VT. Il est
manifeste qu'il y a bien là une
référence au célèbre tarot de Nicolas Conver car les autres cités plus
haut
font tous mentions d'initiales différentes :
François Tourcaty
(FF), Suzanne Bernardin (sans initiale), François Chosson (GS),
etc. Par ailleurs, ce tarot conserve sur le deux de denier la
signature Arnoult 1748 et la barbe de l'ange du Monde. Ainsi, bien
que l'édition de Lequart du Tarot
italien ne semble pas
obligatoirement descendre de celui de Nicolas Conver, celle de Grimaud
en revendique une certaine paternité.
|

Grimaud maquille
Junon au rouge à lèvre

Grimaud fait réapparaître la
signature
du tarot de Nicolas Conver : VT |
|
…et la boucle est bouclée
À la tête de la maison Grimaud depuis 1920,
Paul Marteau remplace du catalogue de l'entreprise, le Tarot
italien par un
jeu qu'il nomme Ancien
tarot de Marseille. Il y apporte deux
changement significatifs : la Papesse
et le Pape
reprennent leur place
(au lieu de Junon
et Jupiter
des dernières éditions du Tarot
italien)
et les couleurs sont à nouveau modifiées.
Pourquoi ces deux changements ? Pour le premier, il est probable que
Paul Marteau, s'intéressant à l'ésotérisme et à l'histoire des jeux de
cartes,
ait voulu rendre les images telles qu'elles étaient au départ, c'est
à dire telles que celles du jeu de Nicolas Conver et des autres tarots
anciens. Quant au choix des
couleurs, deux explications sont à envisager. La première pourrait être
l'économie engendrée par la réduction des couleurs, cependant étant
donné que
nous passons de 6 à 5 couleurs, l'économie ne semble pas énorme
(d'autant que Grimaud possédait ses propres imprimantes). Un
autre facteur, certainement plus déterminant, est que ce tarot adopte
dorénavant les teintes de celui de Nicolas Conver dans son édition de
1880. Il
est donc possible que ce dernier ayant eu un certain succès,
Grimaud ait voulu le concurrencer par un produit similaire. Une autre
hypothèse serait que Paul Marteau, étant lui-même versé dans
l'ésotérisme, il ait préféré par « goût ésotérique », offrir à
ses clients un
tarot répondant à son idéal. Notons que, par rapport à
l'édition du tarot italien, le deux de denier remplace la
signature d'Arnoult par celle de Grimaud et ajoute la date 1930 (mais
conserve aussi celle de 1748, certainement pour faire valoir un ancien
savoir-faire).
En résumé, le tarot de Paul Marteau descend bien de celui de Lequart-Arnoult, car c'est très exactement le même dessin que l'on retrouve dans ces deux tarots (y compris pour le Pape et la Papesse de la première édition de 1880c). Par ailleurs, il descend également de celui de Nicolas Conver de 1880 puisqu'il en reprend les couleurs vives ainsi que le VT du chariot. Le tarot de Lequart-Arnoult, quant à lui, descend d'un ancien tarot, possiblement celui de Nicolas Conver. En conclusion, nous pouvons concilier les deux hypothèses initiales et affirmer ainsi que le tarot de Paul Marteau descend de celui de Lequart ET de celui de Nicolas Conver. |
 
Grimaud aux couleurs du Conver
de 1880
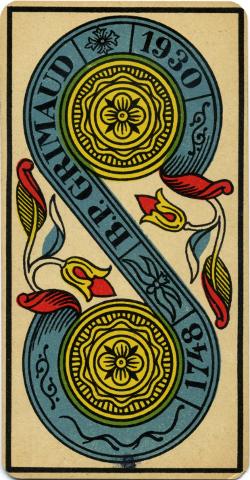
Les deux dates figurent sur le
deux de denier : celle d'Arnoult (1748) et de Grimaud
(1930)
|
|
Comparaison synthétique
Voici un tableau comparatif des diverses éditions de
la lignée
Conver-Lequart-Marteau, avec la date, la signature figurant sur le
blason, le nombre de couleurs (noir compris), la technique
d'impression et le type de tarot.
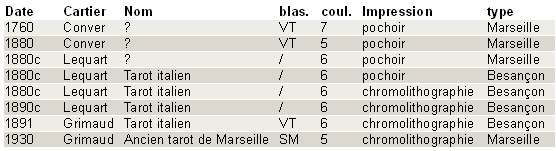 |